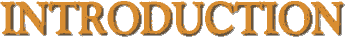
L’amphithéâtre est une structure apparue entre la fin
du II°siècle et le début du I°siècle avant Jésus-Christ (av. J.-C.), en Campanie.
Cette création architecturale est révélatrice du succès grandissant des combats
de gladiateurs et de la vulgarisation de ces jeux, funèbres à l’origine, qui
rendaient hommage aux défunts et se déroulaient sur la place du forum.
La popularité de ces jeux a donc bientôt nécessité l’érection d’une structure
fixe afin d’accueillir les nombreux spectateurs et éviter ainsi les démontages
répétés des gradins en bois installés au forum.
L’amphithéâtre est un monument dérivé du théâtre en
ce qu’il reprend la même subdivision de la cavea
par une distribution régulière des spectateurs et une hiérarchisation de la
qualité des places. La filiation avec le théâtre se limite à la forme car,
si la qualité de l’acoustique est primordiale au théâtre, à l’amphithéâtre
c’est la visibilité qui est importante. De nombreuses recherches ont présidé
à l’élaboration de l’arène parfaite qui offre une qualité de vision identique
quelque soit sa place : l’ellipse.
Le souci de fonctionnalité, par l’organisation de systèmes
de circulation performants, fut résolu avec la création d’amphithéâtres à
structure creuse. La pente naturelle du terrain est ainsi compensée par l’érection
de murs rayonnants qui viennent soutenir les gradins de la cavea,
ménageant ainsi des espaces de circulation par la création de système complexe
de galeries annulaires, travées et escaliers d’accès aux maeniana supérieurs.
Un autre avantage réside dans sa souplesse d’implantation, quel que soit le
terrain. L’aspect esthétique a également été pris en compte puisque cette
structure permet l’édification de façades monumentales, comme en témoigne
l’amphithéâtre d’Arles encore aujourd’hui.
Ce dernier semble faire partie des grandes réalisations
flaviennes (69 à 96 ap. J.-C.) qui ont vu la création des amphithéâtres de
Pouzzoles et du Colisée, édifié entre 72 et 80 à Rome. Si la filiation avec
celui de Nîmes est évidente par leur ressemblance éloquente, la nature du
lien entre l’amphithéâtre d’Arles et le Colisée reste encore l’objet de débats,
ce qui ne permet qu’une datation approximative. Cet édifice, qui se situe
parmi les vingt plus grands amphithéâtres du monde romain (136x107 mètres),
fut donc construit à la fin du I°siècle ap. J.-C., au nord-est de la colonie
césarienne Arelate, fondée en 46 av. J.-C., sur les flancs rocheux de la Hauture,
dominant le Rhône. (fig.1.)
La configuration du terrain est peut-être à l’origine
de sa position oblique par rapport aux axes strictement perpendiculaires de
la cité. Sa construction semble, en tous cas, correspondre à une période d’extension
de la ville puisqu’elle nécessita le démantèlement d’une partie de l’enceinte
primitive. Les documents sont lacunaires quant à la durée d’utilisation du
monument pour des jeux, mais l’arrivée du Christianisme ne semble pas avoir
mis un terme définitif à ces pratiques. Il fut cependant transformé en forteresse
et servit de refuge à la population lors des invasions barbares du VI°siècle.
Les tours, encore visibles aujourd’hui, témoignent de cette occupation médiévale
qui transforma l’amphithéâtre en une réelle cité. (fig.
2)
Le goût romantique du XIX°siècle pour les édifices antiques
fut à l’origine du regain d’intérêt pour ce monument. A partir de 1825, sur
l'initiative du Baron de Chartrouse, maire d’Arles, fut décidé le dégagement
des deux cent douze maisons édifiées à l’intérieur et contre la façade de
l’édifice. Cinq années de travaux permirent d’organiser la première course
de taureaux en 1830, pour célébrer la prise d’Alger, redonnant ainsi son identité
à l’amphithéâtre par l’attribution de sa fonction première de lieu de spectacle.
(fig. 3)
Son classement monument historique en 1840 par Prosper
Mérimée marqua le début d’une politique d’intervention jalonnée de campagnes
de restaurations, nécessitées par l’état extrêmement dégradé et lacunaire
de l’édifice.
L’inscription, en 1981, du patrimoine romain et roman
d’Arles au Patrimoine mondial de l’UNESCO, mit en avant le prestige et le
caractère exceptionnel de cet héritage, dont l’amphithéâtre fait partie. Néanmoins,
depuis une cinquantaine d’années, il ne fait plus l’objet que d’interventions
très ponctuelles. Or, sa situation actuelle exige une action globale d’urgence
afin qu’il puisse continuer à être utilisé, action difficile à définir face
la particularité de cet édifice, à la fois monument touristique et lieu de
spectacle.
La politique d’action actuelle consiste à intervenir
le moins possible sur le monument, or dans quelle mesure peut-on envisager
la conservation, c’est-à-dire le maintien en l’état de l’amphithéâtre d’Arles,
sans avoir recours à la restauration, c’est-à-dire à l’amélioration de cet
état, exigé par l’usage qu’il en est fait ? En d’autres termes, comment mettre
en valeur un édifice aussi singulier, à la double vocation ?
Il apparaît, tout d’abord, nécessaire d’établir un diagnostic
de la situation actuelle du monument afin de mieux appréhender la question
des interventions et leur étendue.
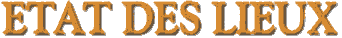
Ce diagnostic se base essentiellement sur une appréhension
visuelle de l’édifice, hors analyse scientifique. Les questions auxquelles
il faut répondre ici sont :
-
Que reste-t-il en place,
-
Dans quel état sont les matériaux,
- Quel est l’usage du monument actuellement ?
1.
Un édifice lacunaire
Le premier abord de l’amphithéâtre est assez imposant
car sa forme générale est très présente dans sa globalité, malgré les visibles
dégradations. Cette impression de bonne conservation est également perceptible
au niveau de l’infrastructure, mais pour d’autres raisons.
Au contraire, la vision intérieure du monument est beaucoup
plus lacunaire et empêche une approche globale.
A.
Une lisibilité satisfaisante
L’aspect extérieur du monument est très endommagé par
les agressions de l’environnement, et les restaurations successives offrent
une vision hétérogène, cependant l’œil perçoit l’ensemble comme un tout. Au
niveau de l’infrastructure, la bonne conservation des matériaux est une réalité,
mais cette homogénéité d’ensemble est, par contre, perturbée par une organisation
des espaces très irrégulière.
1. L’aspect extérieur
Ce qui reste en place extérieurement, bien que très
détérioré, dégage une impression de majesté et de puissance sûrement assez
proche de l’effet d’origine. (fig.
4)
L’environnement actuel y est cependant pour beaucoup
puisque le dégagement périphérique du monument, le mettant à bonne distance
des premières habitations, ainsi que le majestueux perron nord de 1851, deux
opérations dirigées au XIX° siècle par l’architecte Charles Questel, donne
de l’ampleur à l’édifice, mais cela sans pouvoir préjuger de la similitude
antique. (fig. 5)
La façade, haute de 21 mètres, se compose de soixante
travées d’arcades en plein cintre et aux dimensions irrégulières,
superposées sur deux niveaux et constituées de blocs de pierre taillés en
grand appareil, assemblés à joints
vifs.
Chaque arcade est séparée par des piédroits massifs
rectangulaires sur lesquels viennent s’adosser des pilastres d’ordre toscan
au rez-de-chaussée, et des demi-colonnes engagées d’ordre corinthien reposant
sur un petit socle au premier étage. L’architrave, la frise et la corniche
séparant les deux étages suivent les décrochements des pilastres et colonnes en les accentuant, ce qui confère un rythme
régulier et un aspect «découpé » à
l’ensemble.
Une particularité, que l’on retrouve à Nîmes, est à
noter au niveau des voûtes du premier étage dont l’étroitesse semble souligner
l’arcade de façade, comme «un arc doubleau ».
(fig. 6)
Le haut de l’édifice est lacunaire mais l’on peut supposer
la répétition du rythme de l’entablement au niveau supérieur, comme l’évoque
deux restitutions du XIX°siècle et
de 1987 sur le coté ouest du monument. (fig.
7 et 8). De même, la
présence d’un étage d’attique, aujourd’hui disparu, est confirmée par comparaison
avec d’autres amphithéâtres, dont celui de Nîmes notamment. Ce dernier garde
encore les traces du système de fixation des mâts du velum
qui était sûrement identique à Arles, bien que rien ne l’atteste
sur le terrain.
Parmi les ajouts postérieurs, et encore en place actuellement,
les plus visibles et qui donnent toute sa particularité au monument, ce sont
les trois tours qui surmontent les portes nord, ouest et est de l’amphithéâtre.
Ces témoignages médiévaux de la transformation du monument en forteresse viennent
confirmer son occupation tardive, supposée par la présence encore visible
de deux murs édifiés entre les arcades supérieures, dans la partie nord-est
de l’édifice. (fig. 10).
Enfin, de manière
encore plus récente mais non déterminée dans les archives, des grilles ont
été posées entre les arcades au niveau du rez-de-chaussée, empêchant ainsi
le libre accès au monument.
Ainsi, d’une façon générale, l’aspect extérieur de l’amphithéâtre
est assez hétérogène dans les détails, aspect accentué par les multiples remplacements
de blocs créant une rupture dans la lecture. Cependant, dans sa globalité,
c’est une impression de relative uniformité qui s’en dégage, peut-être aussi
«grâce » à son encrassement général.
2. L’infrastructure
L’accès aux sous-sols se fait par la travée 60, correspondant
à l’entrée nord du monument, qui donne sur une première galerie annulaire
en petits moellons. (fig. 9).
Celle-ci longe le mur du podium, en suivant sa
courbe, et soutient les premiers gradins : c’est la galerie de service
(a). Elle est percée de huit
portes ouvrant sur l’arène actuelle, anciens sous-sols probablement aménagés
pour entreposer la machinerie des spectacles.
Le mur opposé de la galerie est scandé par quelques
ouvertures donnant sur des pièces à la fonction indéterminée, qui amènent
parfois directement à la seconde galerie ( c),
parallèle à la première. Cette dernière, à l’appareillage identique, en bon
état de conservation, et également voûtée, n’est pas présente tout autour
du monument car le rocher empêche sa progression par endroits, notamment dans
la moitié sud de l’amphithéâtre. Elle ouvre, de manière régulière, dans sa
paroi la plus proche de l’arène, sur des pièces (b)
qui communiquent, une fois sur deux, avec la galerie intérieure du rez-de-chaussée
(C), à laquelle elle correspond
en sous-sol. (fig. 11 et
12). L’absence de traces
évidentes de système de circulation, comme des escaliers, et d’aménagements
empêche actuellement de définir la fonction précise de ces pièces. On peut
également parfois noter la présence de «gargouilles », dans certaines
de ces pièces, permettant probablement l’évacuation des eaux pluviales récoltées
au niveau de la cavea,
absorbées par le sol perméable.
D’autres locaux sont également accessibles par des ouvertures
dans le mur opposé, mais leur irrégularité, souvent due à la topographie,
et leurs réutilisations successives rendent encore moins lisible leur rôle
antique. C’est à ce niveau de l’infrastructure
et dans la partie nord du monument que sont encore visibles les vestiges du
rempart augustéen et d’une tour, inclus dans la construction. (fig.
13)
Dans l’axe de la porte nord, une galerie radiale importante
relie l’arène actuelle à l’extérieur du monument, par une petite porte latérale
dans le perron.
B.
Une compréhension moins évidente
A l'intérieur, on ne constate pas d'aggravation de l'état
de conservation des matériaux. La différence se situe dans la difficulté à
comprendre la structure, due à la disparition d’une grande partie des aménagements
antiques.
1. Les systèmes de circulation
L’accès actuel, par la porte nord, introduit le visiteur
dans la galerie extérieure du rez-de-chaussée, suggérée en façade, et qui
ceint le monument, comme un anneau (A).
La vision en élévation est faussée par l’absence quasi
totale du promenoir supérieur. En effet, le sol de la galerie du premier étage
(B) était constitué de dalles
monolithes, formant également le couvrement de la galerie du rez-de-chaussée,
or les quelques éléments restants sont dans un état de dégradation avancé,
maintenus par des étais métalliques tout aussi bien conservés. (fig.
14). Seule une succession de ces dalles d’origine porte témoignage de
l’état antique dans la partie est de l’édifice, état restitué du coté sud lors des réfections
d’après-guerre de 1946, sous la direction de Jules Formigé. (fig. 15 et 16).
L’originalité de ce couvrement est à noter car il est propre à l’amphithéâtre
d’Arles et est peut-être dû au souci de maintenir la régularité de la façade
qui, telle quelle, ne permettait pas l’usage traditionnel de la voûte sans
modifier la hauteur du premier étage.
Cette dernière solution fut, en revanche, adoptée à Nîmes. (fig.
17)
L’amphithéâtre à structure creuse se caractérise, dans
son principe, par un système de circulation complexe et développé afin de
permettre une fluidité des mouvements et des évacuations rapides, or, l’aspect
fonctionnel de ces réseaux a aujourd’hui disparu avec eux.
L’alternance des travées X
et Y (fig.
9) est maintenue dans le principe, en ce qu’une arcade sur deux offre
un accès direct à la cavea,
en traversant la galerie intérieure du rez-de-chaussée, de manière systématique
(V1 et V2).
Cependant, l’alternance n’est plus respectée puisqu’une grande partie des
escaliers d’accès à l’entresol ont disparu, et quand ce n’est pas le cas,
ils sont restitués dans un appareillage en pierres ou métallique. (fig.
18 et 19). De plus,
cette répétitivité est contrariée sur les travées axiales, nord-sud et est-ouest,
afin de ménager des dessertes directes compatibles avec la fonction magistrale
de ces portes (défilé de la pompa, accès aux places d’honneur du
podium). (fig. 20)
A partir de l’entresol (D),
l’accès à la galerie extérieure du premier étage est, quelques fois, restitué.
(fig.
21). Les systèmes supérieurs de circulation ont désormais
disparu. Seule une partie de l’escalier menant
à l’attique, inclus dans le mur intermédiaire
des travées, est encore visible et permet de supposer l’organisation des réseaux.
(fig. 22).Outre ces espaces
transversaux ménageant des communications radiales, il existe encore des galeries
annulaires horizontales qui sont définies par madame Fincker comme des espaces
où s’opèrent les «choix directionnels ».
Au niveau du rez-de-chaussée, la galerie intérieure subsiste toujours et est
extrêmement utilisée car elle établit le lien entre l’extérieur et la cavea. L’entresol
existe encore partiellement en élévation dans sa moitié sud, la partie nord
se limitant au niveau du sol.
Peu de choses donc témoignent de la complexe circulation
antique, qui évitait aux personnes des différentes classes de se croiser et
de se mélanger.
2. Les espaces de spectacle
L’occupation actuelle de la cavea par des gradins modernes offre
au moins l’avantage de comprendre la fonction du lieu, proche de son rôle
antique, en revanche, cela ne facilite pas la compréhension des structures
qui restent en place et qui sont très lacunaires. (fig.
23 et 24)
De la cavea
d’origine, il ne reste que les quatre premiers gradins en pierre de taille,
desservis par quatorze vomitoires encore en place et utilisés. Hauts d’environ
50 centimètres et profonds d’environ 90 centimètres, l’assise peut être estimée
à 40 centimètres en moyenne, permettant la circulation des spectateurs, et
l’inclinaison de la pente restituée à 54,5%.
(fig. 25)
Cette première série de gradins (maenianum), appelée aussi podium,
est séparée du deuxième maenianum
par une double hauteur de gradins, encore visible aujourd’hui et soulignée
par un garde-corps métallique qui devait être un parapet en pierre, comme
cela est le cas à Nîmes.
Cette deuxième volée, de dix gradins à l’origine, est
suggérée actuellement par la reconstitution à l’identique de quatre rangées
de gradins, selon le projet de Revoil de 1861, approuvé et réalisé en 1862. A l’œil nu, la distinction se fait par
l’utilisation de petits moellons pour la restauration, qui tranche avec l’appareillage
massif. Quatorze vomitoires desservent également cette partie, disposés en
alternance avec ceux du premier maenianum.
Ces gradins suivent la forme elliptique de l’arène d’origine
et ne s’interrompent qu’au niveau des entrées magistrales nord et sud. L’aspect
général n’est pas d’une régularité rigoureuse et, même ces parties les plus
«antiques » de la cavea,
ont subi diverses restaurations et modifications ponctuelles, comme le comblement
de lacunes par des éléments modernes en bois et métal. Les mêmes matériaux
ont été utilisés pour l’édification des gradins supérieurs, qui s’élèvent
jusqu’au-dessus de l’entresol. Dans la partie inférieure du podium,
une autre série de gradins, en bois ceux-ci, vient donner une forme particulière
à l’arène, tenant plus de l’ovale que de l’ellipse. Ils se trouvent donc en
contrebas du mur du podium, constitué de grandes
dalles en pierre dure hautes de 2,36 mètres, soigneusement appareillées à
l’origine, et qui séparait la cavea
de l’arène antique. (fig. 26)
Un remontage de ce mur, dans la partie sud-ouest de
l’édifice, donne une idée de son état antérieur, avec son couronnement arrondi.
Les traces d’une inscription monumentale sont encore visibles, rappelant l’évergétisme
d’un magistrat local C.Junius Priscus. (fig.
27). La vision de l’amphithéâtre est donc largement modifiée par rapport
à son aspect antique, d’autant que le niveau actuel de l’arène semble se situer
à environ 2 mètres en dessous de la situation d’origine. Le seuil des quatre
portes axiales, s’ouvrant dans le mur du podium,
indique un niveau supérieur du sol, confirmé par l’aspect grossier des blocs
soutenant ce mur, qui ne devaient pas être visibles. Les traces, au sommet
de ces blocs, suggèrent également un système de poutraisons pour soutenir
le plancher en bois de l’arène. (fig.
28)
L’état actuel de l’amphithéâtre permet donc difficilement
de l’imaginer dans son aspect antique, difficulté que l’état des matériaux
utilisés n’atténue pas, loin de là. L’absence de programmes de restaurations
générales et la pratique de réparations ponctuelles donnent, en effet, une
allure hétéroclite au monument, ce qui ne facilite pas toujours sa lecture.
II.
Etat des matériaux utilisés
Le matériau principal utilisé dans la construction de
l’amphithéâtre est, bien évidemment, la pierre. D’autres éléments, annexes,
peuvent être considérés comme partie prenante du monument, tels les gradins
modernes, mais nous ne les traiterons pas ici.
La pierre étant le matériau le plus résistant de l’époque,
il est normal de le retrouver à tous les niveaux de l’édifice : structure
et infrastructure. Malgré des dégradations visibles, le fait qu’il soit toujours
debout, après presque 2000 ans de péripéties, témoigne de la légitimité de
ce choix et de la qualité de la mise en œuvre. Cependant, les dommages sont
là, il apparaît donc intéressant d’analyser, en premier lieu, la nature des
matériaux utilisés pour mieux appréhender les dégradations et comprendre les mécanismes de l’altération.
A.
Nature du matériau
L’analyse est ici réduite à une appréhension visuelle,
faute d’études scientifiques préexistantes, par conséquent son exhaustivité
peut être sujette à caution. L’aspect extérieur est donc le seul paramètre
pris en compte pour déterminer la nature des matériaux utilisés, le degré
d’altération servant, le plus souvent, d’indicateur.
1. Analyse macroscopique et cartographie esquissée
L’édifice semble constitué de pierres de différentes
natures.
Les pierres de taille sont visibles au niveau du gros
œuvre, c’est-à-dire pour la façade, la galerie extérieure du rez-de-chaussée
dans son élévation ainsi que pour la plupart des arcades et portes des galeries
et travées. Outre un avantage technique évident pour la construction d’un
édifice aussi haut (21 mètres), l’emploi de ces blocs, soigneusement appareillés,
était, peut-être, également motivé par un souci esthétique, conférant à l’ensemble
une certaine majesté et soulignant les points de passages.
Visuellement, cette pierre a une couleur beige-crème,
un aspect assez homogène avec des inclusions de coquillages fossilisés disposés
en strates, et un grain qui semble relativement moyen. Il s’agit donc d’une
roche sédimentaire, d’un calcaire, dont la provenance ne peut être affirmée
avec certitude. Les archives parlent souvent de la pierre de Fontvieille,
utilisée aussi au théâtre d’Arles, ou de celle des Baux.
Dans tous les cas, les caractéristiques sont similaires et il apparaît logique
que l’approvisionnement se soit fait dans une carrière proche, pour des raisons
pratiques de transport.
De même, les blocs de remplacement utilisés pour des restaurations récentes,
parfois très visibles en façade, sont probablement de même nature avec un
moindre degré d’altération .
Ce même type de calcaire, facile à travailler, semble
avoir été employé dans d’autres parties de l’édifice, notamment pour les parois
des galeries annulaires intérieures et travées du rez-de-chaussée, de l’entresol
et des sous-sols ainsi que pour l’édification des tours. En effet, la taille
et l’appareillage soignés de ces petits moellons tranchent avec l’aspect plus
rude de ceux utilisés dans les voûtes de ces mêmes parties. (fig.
29)
On peut supposer,
pour ces derniers, la présence d’un calcaire, puisque les caractéristiques
visuelles sont proches des autres pierres, mais de nature plus dure, ce qui
expliquerait une taille moins régulière. Leur présence est également à signaler,
comme matériau de «fourrage», à l’intérieur des murs des galeries et des travées.
C’est la technique de l’emplecton, terme de Vitruve désignant une maçonnerie fourrée (remplissage
intérieur), qui est donc composée de ces pierrailles non dégauchies, noyées
dans un mortier en même temps que les moellons de parements.
(fig. 30). Les gradins restaurés
au XIX° siècle du deuxième maenianum ainsi que les murs médiévaux des arcades, semblent
également faits à partir de ce calcaire.
De couleur plus grisée,
les blocs des premiers gradins antiques et des emmarchements, ainsi que les
dalles du promenoir supérieur semblent plus proches du calcaire dur des petits
moellons précédents que des blocs de calcaire coquillé du gros œuvre, malgré
une similitude dans la taille en grand appareil.
Enfin, les dalles de parement du mur du podium
ont un aspect plus blanchâtre. Ce calcaire, de structure cristalline, rappelle
le marbre, ce qui expliquerait son utilisation comme ornement.
2. Les propriétés induites
Compte tenu de la durabilité des différentes roches
en présence, c’est-à-dire de leur résistance aux dégradations, on peut déduire
de ces observations des propriétés différentes.
Ainsi, le calcaire coquillé, le plus utilisé sur le
monument, semble beaucoup plus sensible à certains types d’agressions, sensibilité
peut-être favorisée par une porosité assez élevée et une dureté (résistance
à la rayure) amoindrie. Au contraire, sa résistance mécanique aux charges
ou aux chocs doit être plutôt bonne, ou devait l’être dans son état d’origine,
vu l’usage qu’il en a été fait et l’absence de fissures importantes.
Le calcaire des voûtes et de l’emplecton a une dureté visiblement plus élevée compte tenu de l’état
de sa structure, relativement bonne par rapport aux circonstances de sa mise
en œuvre. En effet, les voûtes de la galerie annulaire de l’entresol, dans
son état actuel, sont soumises à la violence des pluies, or, la pierre en
elle-même ne semble subir que des dégradations de surface, ce qui laisse supposer
une porosité peu importante. De même, une partie de la structure des gradins
modernes repose sur ces voûtes peu épaisses, or, outre une répartition des
charges atténuant la compression directe, cela indique cependant une résistance
mécanique élevée. (fig. 31)
Enfin, la pierre utilisée pour les gradins antiques,
le mur du podium et le promenoir supérieur, doit
avoir le degré de compaction le plus élevé. Ainsi, les gradins, par leur utilisation
intensive et leur prise au vent et à la pluie, ne sont que peu détériorés,
ce qui suppose également une dureté très importante. L’état des dalles du
podium et du promenoir est beaucoup plus dégradé
mais pour d’autres raisons.
B. Diagnostic des causes de l’altération et
ses mécanismes
« Tous
matériaux placés dans un environnement déterminé tendent à se mettre en équilibre
avec lui ». La modification de l’environnement oblige le matériau à se transformer,
ce qui aboutit à un changement rapide et évident de ses caractéristiques originelles :
c’est l’altération.
1. La cause principale d’altération : les sels
L’action combinée de l’eau et des sels est ce qui engendre
le plus de dégradation sur le monument. Les sels viennent modifier la composition
minéralogique de la pierre et l’altèrent par le phénomène de cristallisation
saline.
Ce phénomène peut s’expliquer ainsi : la pierre
poreuse aspire les molécules d’eau comme une éponge ; ces molécules pénètrent
dans les capillaires de la pierre et se déplacent facilement entre ceux-ci
en fonction des conditions thermohygrométriques externes ; les sels se
dissolvent dans l’eau et lorsque la température augmente, l’eau s’évapore
en remontant à la surface ; les sels restent présents dans les capillaires
après évaporation ; ils cristallisent, soit en surface (efflorescence),
soit au-dessous de la surface (subflorescence), provoquant la désagrégation
de la pierre qui se manifeste par une exfoliation de la surface ou un détachement
de croûtes superficielles en plaques.
La cristallisation saline
est le mécanisme d’altération qui se retrouve sur l’ensemble du monument.
Une des conséquences les plus visibles de ce phénomène est l’alvéolisation,
principalement localisée sur l’anneau extérieur du monument,
en façade et dans la galerie. (fig.
32). A l’intérieur également, de manière moins développée, certains cas
sont à signaler, toujours sur des blocs de même nature. Cette dégradation
se caractérise par des enlèvements de matière très importants, formant des
alvéoles parfois profondes, d’où le nom. Cela donne un aspect de «gruyère »
à la pierre subissant ce genre d’altération avec parfois, dans sa forme la
plus exacerbée, une désagrégation du matériau telle que le profil original du
bloc disparaît complètement.
Les sels actifs dans ce cas sont essentiellement issus
de l’eau de pluie, probablement chargée de chlorure provenant de l’eau de
mer pulvérisée portée par les vents, et de sulfates dus à la pollution atmosphérique.
Une autre source de sels est à chercher dans le sol, où l’eau de ruissellement
ou de la nappe phréatique, chargée de nitrates, pénètre dans la pierre par
succion capillaire. Ces deux sources, venant du bas et du haut du monument,
expliquent la présence d’un front de capillarité, lieu de rencontre des différents
sels, où la pierre est beaucoup plus attaquée que dans les parties périphériques.
(fig. 33). L’action du vent,
parfois violent sur ce point en hauteur, fonctionne comme un accélérateur
de la dégradation, car il creuse la pierre, emportant la surface dégradée,
surtout au niveau des strates de sédiments, et les sous-couches attaquées
par la cristallisation.
Les premières phases du processus de dégradation donnent
un aspect érodé général à tous les blocs de même nature, atténuant ainsi les
contours et adoucissant les arêtes qui devaient être vives à l’origine.
L’état de dégradation des dalles du podium
et du promenoir, évoqué plus haut, est essentiellement dû à l’ajout de goujons
et d’étais en fer. Le fer est un matériau moins stable chimiquement que la
pierre, qui se corrode rapidement sous l’effet des changements climatiques,
entraînant une augmentation de son volume par formation de couches d’oxydes,
d’hydrates ou de carbonates. Cette corrosion provoque la formation de sels
solubles dans l’eau qui attaquent la pierre et qui lui donne une couleur rouille
typique. Le ciment ajouté, afin d’améliorer l’adhésion au support des dalles
du podium , est néfaste pour les mêmes
raisons : production de sels hydrosolubles dangereux. (fig.
34 et 35)
Enfin, un autre phénomène d’altération chimique se manifeste
par la présence de croûtes noires, qui ont d’ailleurs plutôt l’aspect de coulures,
et qui sont présentes de manière très localisée sur l’ensemble de l’édifice.
Ainsi, l’endroit le plus visible de leur installation est l’intérieur des
arcades du premier étage, sur les voûtes. Or, en y regardant de plus près,
on constate leur présence sur l’ensemble des blocs de la galerie annulaire
extérieure, que ce soit au rez-de-chaussée ou à l’étage. (fig.
36 et 37). En façade
également quelques traces sont visibles mais que dans des parties en retrait,
davantage protégées de la pluie qui doit avoir un effet lessivant par rapport
à ce genre de dégradation, comme sous la corniche, par exemple. La pollution
atmosphérique est à l’origine de la formation de ces dépôts. Ils sont de cohésion
et d’adhérence variables, et composés de différentes particules, poreuses
ou non, issues de la combustion du pétrole et du charbon, liées par des cristaux
de gypse. C’est ce gypse qui est une des principales causes d’altération par
les croûtes noires. En effet, il est issu de l’oxydation des composés de soufre,
contenus dans l’atmosphère, en acide sulfurique ou en sulfates, qui réagit
avec le carbonate de calcium, composant du calcaire, pour donner le sulfate
de calcium ou gypse. L’altération par ces croûtes noires est donc provoquée
par une corrosion chimique mais aussi par la cristallisation des sels présents
dans ces dépôts. Ces mécanismes peuvent être accentués par l’épaississement
de cette croûte qui, de ce fait, devient moins poreuse et, donc limite ces
échanges avec la pierre, l’étouffant, provoquant des comportements thermiques
et mécaniques différents. La désintégration du matériau sous-jacent altéré
est très visible dans ce cas car la pierre, plus claire mais « rongée »,
réapparaît à côté des dépôts noirâtres. (fig.
38)
2. Les autres altérations : physiques et biologiques
Les altérations physiques les plus visibles sur le monument
semblent être dues à la mise en œuvre. L’action de l’homme est donc la plus
évidente à ce niveau. En effet, les altérations observées sur le monument
de cet ordre, peuvent être identifiées comme les différentes associations
de matériaux faites par l’homme au moment de la construction ou des «réparations ».
Mais ce sont les écarts thermiques qui sont réellement à l’origine de ces
dégradations, par la pression mécanique engendrée.
Les altérations inhérentes à la construction sont visibles
surtout au niveau des dalles du promenoir. La pose d’étais en fer, censés
les soutenir, les a bloquées de façon rigide et a crée des tensions inhérentes
aux différences de dilatation entre les deux matériaux. En effet, la pierre
ayant une conductibilité, c’est-à-dire une capacité à propager la chaleur,
deux fois moindre que le métal, ce dernier est plus sensible aux variations
climatiques et donc se dilate de manière plus importante. Ainsi, ce véritable
carcan métallique a entraîné de multiples ruptures, allant jusqu’à l’éclatement
de la pierre. L’encastrement des dalles n’a fait qu’ajouter à leur fragilité
en créant des tensions supplémentaires. (fig.
39)
Au niveau des dalles du podium,
le système de fixation du XIX°siècle par des goujons en fer, a provoqué le
même problème de pression mécanique dû à des différences de dilatation et
se matérialisant par des fissures et des enlèvements en plaques.
La biodégradation est un phénomène, dû à l’action des
êtres vivants, qui peut se définir ainsi : « N’importe quel type
d’altération irréversible, conséquence de l’activité métabolique d’un ou plusieurs
populations vivantes, quelque soit l’ordre de grandeur des individus qui les
composent ».
Le phénomène le plus répandu de biodégradation est la
micro-végétation localisée sur les voûtes internes des galeries te travées.
Compte tenu de l’atmosphère humide et sombre, il peut s’agir d’algues et de
champignons microscopiques, producteurs d’acides très corrosifs.
Ainsi, les algues, d’aspect noirâtre ou verdâtre, libèrent
des acides qui décomposent le carbonate de calcium du calcaire, c’est pour
cela qu’elles se développent essentiellement en périphérie des moellons dont
la porosité est inférieure à celle du mortier de chaux qui les lient, véritable
garde-manger pour elles. Les champignons, quant à eux, produisent des acides
organiques qui forment, avec le calcium, le fer ou le potassium, des sels
solubles (acétates, citrates, …) provoquant des efflorescences salines, des
tâches colorées ou des boursouflures. (fig.
40 et 41)
Un autre type de micro-végétation, localisé davantage
à l’extérieur du monument et caractérisé par ses couleurs vives : les
lichens. Ils se développent essentiellement sur le sommet de l’anneau extérieur
et ont une action métabolique acide vis-à-vis des blocs calcaires qu’ils recouvrent.
(fig. 42)
Les végétaux, s’insérant dans les joints ou les fissures,
ont également une action chimique sur les pierres par les acides humides qu’ils
libèrent, mais aussi une action mécanique par la croissance des racines à
l’intérieur des failles. (fig.
43)
Enfin, un autre agent de dégradation par action chimique
est situé dans les excréments de pigeons qui, chargés d'ammoniac, décomposent
le carbonate de calcium et réduisent la surface de la pierre en poudre.
III.
L’utilisation actuelle du monument
Un autre aspect qu’il convient d’aborder afin de mieux
appréhender la situation de l’amphithéâtre, est son utilisation.
En effet, si sa fonction de lieu de spectacle se perpétue
à l’heure actuelle au travers des manifestations taurines et folkloriques,
sa qualité de lieu touristique, très visité, introduit une seconde dimension
à son utilisation dont il faut tenir compte.
Ces deux aspects de l’usage du monument sont en déséquilibre
actuellement et ces pratiques induisent des problèmes non négligeables.
A.
La prédominance du lieu de
spectacle
L’observation de la structure et de son occupation semble
indiquer une utilisation privilégiée de l’amphithéâtre en tant que lieu de
spectacle, fonction première du monument, mais au détriment de l’aspect touristique.
1. Des cheminements proches mais divergents
Les billetteries sont les premières structures que le
visiteur ou le spectateur rencontre lors de sa venue à l’amphithéâtre. Toutes
deux situées au niveau de l’entrée nord, seul accès à l’intérieur du monument,
elles sont suffisamment proches pour susciter une inévitable comparaison.
(fig. 44 et 45)
Si la billetterie des visiteurs se caractérise essentiellement
par sa discrétion, cela est dû au peu d’espace dont elle dispose. En revanche,
le bureau de location des places de spectacles est visuellement inévitable
car il occupe toute la largeur d’une alvéole dans la galerie extérieure du
rez-de-chaussée et aborde frontalement le public. Cette installation qui,
de toute évidence, est faite pour être vue et reconnue, a le mérite d’offrir
un espace de travail suffisamment grand et confortable à son personnel, ce
qui n’est pas forcément le cas pour la billetterie des visiteurs, dont la
vétusté est notoire.
Une fois les places achetées, il s’agit pour le public
de s’orienter dans le monument. Là aussi, les moyens mis à disposition divergent.
Pour le spectateur, retrouver sa place rapidement est facilité par une numérotation
assez simple des travées de 1 à 60, en commençant par la travée à l’est de
la porte nord, un découpage des niveaux de gradins compréhensible et, souvent,
une habitude du lieu qui permet une orientation facile. Le visiteur, présent
pour la première fois et dont le but n’est pas de trouver une place sur les
gradins, se trouve plus démuni dans son approche car il manque d’information.
Certes, une plaquette est vendue à la billetterie, permettant d’appréhender
historiquement l’amphithéâtre, de le resituer dans son contexte et d’envisager
ce qu’il fut, mais la vision actuelle de l’édifice et sa compréhension sont
des aspects encore obscures. Or, face à cet ensemble lacunaire, l’imagination
requise pour envisager un état originel, malgré des explications, peut faire
défaut sans la présence d’indices pertinents sur le terrain. Le seul « parcours »
proposé est la visite de la tour nord, pour admirer le point de vue. (fig.
46)
Le déplacement dans les galeries et travées, véritable
dédale pour le néophyte, amène inévitablement le public au niveau des gradins,
car l’important c’est l’arène, qu’on soit touriste ou aficionado. Le problème
se situe ici dans l’évidente inadéquation du système de gradins en place par
rapport au monument, à sa mise en valeur et à sa protection. En effet, les
gradins situés au niveau de l’arène occupent un espace originellement dévolu
à la piste, ce qui modifie sa forme, qui n’est plus elliptique, et soumet
le mur de podium aux frottements. De plus,
leur installation ne semble pas avoir été prévue pour un usage à long terme,
vu les matériaux utilisés et leur agencement. (fig.
47). La structure métallique des gradins supérieurs permet, par contre,
une assez bonne lecture de l’ensemble de l’amphithéâtre par un effet de «transparence ».
Toutefois, lorsque le visiteur est situé au niveau de l’entresol, dans sa
partie découverte, il se retrouve derrière la structure des gradins et sa
vision est gênée par celle-ci. (fig.
48). Certes, ce point de vue était inexistant à l’origine car cette partie
était voûtée, mais au regard de la situation actuelle, un compromis s’avère
peut-être nécessaire, dans la mesure où il satisferait le plus grand nombre.
Un autre aspect, induit par la prédominance de la fonction de spectacle du monument, est l’important support logistique mis en place pour
en assurer le bon déroulement.
2. L’importance de la logistique
Comme à l’origine, on retrouve l’essentiel de ces structures
installées dans les sous-sols de l’amphithéâtre.
Ainsi, de part et d’autre de l’axe nord, se développent
des locaux réutilisés en grande partie pour loger les installations nécessaires
à l’organisation des spectacles taurins : vestiaires des raseteurs, installations
sanitaires, infirmerie, bloc opératoire, et chapelle des toreros. De l’autre
coté, dans l’axe de la porte sud, la même galerie radiale semble se développer
beaucoup moins profondément, mais elle est à demi enterrée, ce qui ne permet
pas une utilisation similaire. Toutefois, le toril y a été installé autour,
dans la galerie de service. A ce niveau, des locaux techniques ont également
été installés, pour le système électrique notamment, et du matériel mobile,
comme des barrières, est stocké de manière aléatoire dans les galeries annulaires.
A l’heure actuelle, cette occupation n’est pas vraiment
gênante dans la mesure où les infrastructures ne sont pas visibles dans leur
totalité par le visiteur. Dans les visites guidées, seule une partie de la
galerie proche de l’arène est visitable. Le reste n’a pas été aménagé pour
cela, ainsi le système d’éclairage est parfois inexistant. De plus, l’usage
qu’il en est fait doit être assez proche de la fonction antique : cages
des fauves (carceres), loges pour les
gladiateurs, chapelle (sacellum). L’absence
de locaux aménagés sous la piste, comme ce devait être le cas à l’origine,
réduit l’occupation des sous-sols à la proximité de l’arène par souci d’accessibilité
et de commodité.
De ce fait, une partie de la logistique a été installée
au niveau des galeries et travées de la superstructure, l’aménagement y étant
plus aisé. Ainsi, des armoires métalliques sont mises dans les passages, des
barrières sont entreposées dans les travées, des billetteries mobiles sont
installées contre les grilles et des espaces sont réoccupés. De même, le système
d'alimentation électrique court le long des murs. (fig.
49 - 50 - 51
- 52).
B.
Les dangers inhérents à une
telle utilisation
Ils sont de deux ordres : d’une part, les conséquences
néfastes pour le monument et, d’autre part, celles dommageables pour le public.
1. Les conséquences dommageables pour le monument
L’état de la pierre, élément fondamental constituant
le monument, a été analysé précédemment. Les seuls éléments modernes abordés
furent ceux ajoutés à la pierre, comme les étais métalliques.
Par contre, les structures modernes coexistantes avec
la pierre sur le monument, non encore évoquées, sont intéressantes à étudier
ici car elles entraînent des modifications dans la structure qui peuvent être
dommageables.
Ainsi, les gradins, installés pour recevoir les spectateurs
en remplacement des aménagements antiques, sont-ils une source importante
d’inconvénients aujourd’hui, au-delà de la question esthétique. Outre les
problèmes de charge mécanique que font subir les gradins supérieurs aux voûtes
de l’entresol, sur lesquelles ils prennent en partie appui, c’est surtout
un problème d’entretien et de vétusté qui est ici à noter.
En effet, hors la saison des spectacles tout du moins,
les gradins ne sont pratiquement jamais nettoyés. De plus, ils subissent les
intempéries et les mauvais traitements du public, d’où un état assez dégradé
des structures en bois.
Cette situation est regrettable car, en basse saison,
le monument reste ouvert à la visite, ce qui donne une impression de négligence
au public.
D’autres ajouts récents viennent perturber la structure
du monument, toujours inhérents à sa réutilisation. En fait, c’est moins l’usage
des espaces qui posent problème que les conditions de leur aménagement. Ainsi,
au niveau des sous-sols, l’infirmerie, les vestiaires ou le toril, ont été
faits sans vraiment tenir compte de l’espace antique occupé et en le modifiant
pour lui donner un aspect moderne. C’est ainsi que les vestiaires rectangulaires,
en matériaux préfabriqués, ont été installés en 1978 dans une galerie annulaire
voûtée, l’occultant entièrement. L’aspect utilitaire de ces espaces entraîne
également une négligence au niveau de l’entretien qui peut aller jusqu’à la
transformation de certains endroits en véritables dépotoirs. (fig.
53)
Le parpaing est également fréquemment utilisé pour diviser
les espaces. Cela est à constater au niveau du toril mais également pour boucher
certaines alvéoles de la galerie intérieure du rez-de-chaussée. (fig.
54). Or, autant du point de vue esthétique qu’historique, ce type de matériau,
utilisé à nu, n’est peut-être pas le plus approprié pour ce genre de monument.
Enfin, au niveau de la galerie extérieure du rez-de-chaussée,
de nombreuses alvéoles sont obstruées par des palissades ou des murs en béton
et servent à entreposer du matériel. L’une d’elles a même été réaménagée pour
y installer des bureaux. (fig.
55 - 56 - 57)
Tout ceci concerne davantage l’amphithéâtre car cela
a attrait, en priorité, à sa structure, mais le public subit aussi, plus ou
moins directement, ces inconvénients.
2. Les conséquences dommageables pour le public
Les problèmes que peut rencontrer régulièrement le public
ne sont pas forcément les plus graves. Il s’agit essentiellement d’une question
de confort et cela, surtout pour le spectateur qui subit, en plus, la foule
et la chaleur en période estivale.
En effet, les gradins ne sont pas vraiment adaptés à
une station assise prolongée et la visibilité, élément fondamental dans ce
type d’édifice, ne doit pas toujours être satisfaisante, surtout pour les
spectacles nocturnes compte tenu du système d’éclairage en place actuellement.
Les installations sanitaires n’améliorent pas le bien-être
du public, vu leur nombre (3 pour les femmes) largement insuffisant par rapport
à la fréquentation, qui est en moyenne de 10000 personnes lors des spectacles,
et vu leur vétusté notoire. (fig.
58). Les normes d’hygiène ne sont donc pas vraiment respectées, hygiène
que le nombre de poubelles et de points d’eau ne contribue pas à favoriser.
Les questions de sécurité sont autrement plus importantes
et lourdes en conséquence pour le public. Heureusement, les accidents sont
assez rares mais le danger reste présent. En effet, l’un des principaux inconvénients
du monument, ce sont ses vides, très nombreux, et le balisage de ces zones
dangereuses reste lacunaire. Ces parties interdites pour éviter une chute
ou des zones fragiles de l’édifice, sont matériellement signalées par des
chaînettes, agrémentées ou non de petits panneaux «sens interdit », ou
par des barres de fer. (fig.
59). Dans les deux cas, ces systèmes empêchent symboliquement le passage,
mais la vigilance reste le moyen le plus sûr d’éviter un accident car certains
endroits sont presque dans l’obscurité, notamment dans la galerie du rez-de-chaussée.
Lors des spectacles, l’accès à la tour nord, qui permettait
au public de s’installer sur les extrados des arcades de l’anneau extérieur,
est désormais interdit et l’on comprend pourquoi. Mais, mis à part cette mesure
préventive, le visiteur reste libre de son comportement. (fig.
60). Un autre souci relatif à des questions de sécurité est le problème
d’évacuation du monument en cas de danger. L’ouverture des quatre portes axiales
pour la sortie des spectacles est suffisante en temps normal, mais elle ne
permet peut-être pas d’éviter les mouvements de panique et les stationnements
prolongés et dangereux dans les galeries. Dans ce cas, l’ouverture des autres
grilles mobiles doit être extrêmement rapide.
Ainsi, l’amphithéâtre d’Arles est un monument très lacunaire
dont l’utilisation régulière, depuis son dégagement, exige, actuellement,
une restauration d’ensemble afin de lui permettre de continuer à exister.
Pour cela, une intervention d’urgence est nécessaire,
compte tenu de l’état de dégradation du monument, mais la définition d’une
politique d’action est également indispensable, or, nous allons voir que les
paramètres à considérer sont très divers, voire divergents.
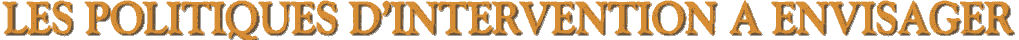
Il ne peut y avoir une solution toute faite aux problèmes,
ni même une seule politique d’intervention envisageable.
En effet, il s’agit de trouver un compromis entre les
différents acteurs du projet de restauration (la municipalité, la conservation
régionale des monuments historiques et l’architecte en chef des monuments
historiques), qui peuvent avoir des intérêts et des objectifs différents,
et prendre en compte la particularité du monument.
Comme pour toute intervention sur les monuments historiques,
la Charte de Venise
de 1964 sous-tend le projet en posant les principes fondamentaux de conservation
et de restauration, spécifiques à chaque étape.
I.
Les actions de base
Ces actions sont induites par la nécessité d’intervenir
rapidement pour la sauvegarde «physique » du monument, d’où l’attention
première portée à la structure.
A.
Les examens préliminaires
« La conservation et la restauration des monuments
constituent une discipline qui fait appel à toutes les sciences et à toutes
les techniques qui peuvent contribuer à l’étude et à la sauvegarde du patrimoine
monumental. » - article 2 de la
Charte de Venise
Ces différentes sciences et techniques, contribuant
à l’étude du monument, vont permettre, par la connaissance du matériau et
de ses altérations, de définir une politique d’intervention sur la structure,
la plus appropriée. Celle-ci doit respecter l’œuvre, donc être sans danger,
et elle doit également être minimum, donc davantage ralentir les processus
d’altération que les stopper.
1. Les analyses du matériau en laboratoire
Cette étude élémentaire, qui n’a jamais été réalisée,
se fait à partir d’échantillons prélevés de chaque type de pierre et des différents
éléments d’altération, comme les croûtes noires ou les mousses et algues,
par grattage.
Les analyses minéralogiques et pétrographiques effectuées
sur le matériau pierreux viennent confirmer ou infirmer les résultats de l’examen
macroscopique fait au préalable sur le terrain, ayant permis la reconnaissance
des minéraux composant la roche, en l’occurrence des calcaires de différentes
natures.
L’examen en coupe au microscope établit la stratigraphie
des minéraux qui sont, ensuite, analysés en lames minces au microscope polarisant
pour les identifier. On peut ainsi établir la genèse de la roche, la classer
et déterminer sa provenance, ce qui, pour l’amphithéâtre, va permettre de
vérifier les hypothèses émises dans les archives.
Afin d’obtenir des informations sur les mécanismes d’altération,
comme pour la pierre, l’examen en coupe au microscope des croûtes noires et
des dépôts superficiels permet de visualiser les couches successives, dont
la composition est déterminée par analyse au microscope stéréoscopique et
électronique à balayage. Le recours aux rayons X est utile pour identifier
les phases cristallines de ces dépôts, complément important de la compréhension
du processus de dégradation.
Les analyses chimiques sont intéressantes à effectuer
pour choisir la technique de nettoyage la plus adaptée, afin qu’elle ne soit
pas un facteur aggravant d’altération. En connaissant la composition chimique
qualitative et quantitative de chaque matériau utilisé ainsi que des salissures
à enlever, le choix du nettoyage pourra être plus pertinent, en fonction des
propriétés déduites. Ces propriétés, qui viennent corroborer ou non celles
induites par l’observation, donnent des indications sur les capacités techniques
des pierres, que des tests particuliers viennent compléter, pour déterminer
la densité, la résistance à la compression, à la traction ou à la flexion.
Un état de conservation général du matériau peut ainsi être envisagé.
La nature des différents sels présents dans la roche
peut également être déterminée par ce type d’analyse, ce qui est très intéressant
dans le cas de l’amphithéâtre d’Arles puisque le phénomène de cristallisation
saline est une des causes d’altération les plus répandues sur le monument.
Une série de tests supplémentaires peut également apporter des compléments
d’information, comme la mesure du degré de salinité par rapport à la propriété
capillaire de la pierre. Savoir, de manière précise, d’où viennent ces sels
et quelle est leur nature, permet de mieux appréhender les différents mécanismes
de dégradation et d’envisager les moyens de les enrayer.
L’identification des différentes plantes, algues microscopiques,
champignons, mousses ou lichens se fait grâce à des analyses biologiques à
partir d’échantillons. Les résultats obtenus vont donc permettre de choisir
un biocide adapté à chaque élément dégradant, qui devra être sans danger pour
le matériau et l’utilisateur.
Ces différentes analyses, en déterminant les caractéristiques
des matériaux utilisés et en définissant les différentes altérations, devraient
aboutir à l’établissement d’une cartographie précise de chaque type de pierre
et dégradation.
2. Les analyses du matériau dans son contexte
La nécessaire localisation des différents résultats
issus des examens, se fait à partir de relevés sur le monument. Ce travail
sur le terrain est complété par l’étude technique de l’environnement qui permet
d’évaluer l’influence de celui-ci en tant que facteur causal ou aggravant
de la dégradation.
L’étude de l’hydraulique semble être une priorité, pour
l’amphithéâtre d’Arles, compte tenu des nombreux problèmes liés à l’eau.
A l’exemple de Nîmes, les chemins d’eau sont à étudier
afin de trouver une solution pour maîtriser ce facteur majeur d’altération.
La pénétration de l’eau de pluie dans la pierre semble se faire soit directement
au niveau des surfaces en contact avec elle, soit par infiltration, au travers
de surfaces non étanches, permettant une circulation verticale de haut en
bas dans la structure du monument.
Une étude hydrogéologique serait également appropriée
afin de mieux analyser les éventuels effets du ruissellement de l’eau de pluie
sous le monument et des remontées capillaires, de cette eau et de celle provenant
de la nappe phréatique, cette fois de bas en haut.
Une étude géologique peut s’avérer également intéressante.
Cependant, il s’agirait davantage d’aborder la morphologie du terrain plutôt
que d’analyser sa structure. En effet, celle-ci s’appréhende facilement par
les affleurements visibles du côté ouest de l’amphithéâtre, ce qui éviterait
le recours à des carottages. (fig.
61). Cette étude topographique pourrait se faire par des sondages géologiques
afin de déterminer le profil de la pente et révéler ainsi une éventuelle dépression.
Compte tenu de l’usage du monument, certaines mesures
devraient révéler l’incidence technique de son utilisation actuelle sur sa
structure. Ainsi, on peut envisager, comme à Nîmes, un relevé des fissures
éventuelles, en considérer les causes (poids supporté par les gradins, vibrations
inhérentes aux mouvements de foule et aux spectacles, mouvements du terrain)
et étudier leur évolution.
Enfin, la mesure du taux de pollution à différents endroits
du monument et à différents moments, de la journée et de l’année, est un paramètre
intéressant à étudier en ce qu’il révèle, notamment, l’incidence des pluies
et du vent comme propagateurs ou dissipateurs de la pollution atmosphérique.
Cependant, l’interdiction de stationner autour de l’édifice, depuis 1996,
devrait atténuer l’importance de ce problème.
L’outil informatique apparaît approprié pour regrouper
les données de ces divers relevés, permettant de réaliser ainsi une modélisation
du monument, le faisant évoluer selon les paramètres enregistrés, et de définir
une politique d’intervention plus adéquate.
B.
Les interventions proprement
dites
Certains principes, issus des articles 9 à 13 de la
Charte de Venise, donnent
un cadre à ces pratiques : principe d’intervention minimum (il s’agit
plus de ralentir les altérations que de refaire à neuf, d’où des substitutions
réduites au maximum), principes de lisibilité et de réversibilité des interventions.
Toujours est-il qu’il vaut mieux prévenir que guérir,
mais lorsque le mal est déjà fait, la prévention passe d’abord par la guérison.
1. La guérison : la restauration
La première opération à envisager est le nettoyage,
intervention délicate car, contrairement au principe posé juste avant, elle
est irréversible.
En fait, il s’agit d’enlever les dépôts superficiels,
quels qu’ils soient, sans endommager la couche de surface originelle afin
de conserver son authenticité à la pierre. Donc, la méthode de nettoyage choisie
doit être contrôlable dans toutes ses phases, ne pas produire de matières
dangereuses qui pourraient accélérer le processus de dégradation plutôt que
de le freiner, ni produire de modifications ultérieures néfastes.
Le plus souvent, des méthodes mécaniques, comme le micro-sablage,
et chimiques sont associées. Ces dernières se caractérisent surtout par une
action par dilatation ou dissolution des dépôts afin d’affaiblir la cohésion
des molécules. La nature des solvants choisis dépend de la composition chimique
des dépôts, de leur morphologie, de leur épaisseur et des propriétés des composants
de la pierre, d’où l’importance des analyses en laboratoire.
Parmi les agents solvants
souvent utilisés, on retrouve l’eau déminéralisée qui, en s’infiltrant dans
les pores, dissout le gypse, principal composant des croûtes noires, et provoque
un ramollissement des dépôts, faciles à retirer mécaniquement. Ce fut
la solution choisie par l’architecte en chef J.P. Dufoix pour la campagne
de restauration de 1987 : eau pure associée à un brossage.
Le risque de cette pratique est d’accentuer la cristallisation
saline par l’utilisation d’une solution aqueuse. Pour vérifier son innocuité
dans le cas de l’amphithéâtre, il suffirait d’analyser les réactions de la
pierre traitée ainsi il y a treize ans. Visuellement, en tous cas, le résultat semble
satisfaisant, mais une subflorescence reste toujours possible.
Les organismes vivants sont, quant à eux, à éliminer
par des produits chimiques, comme des fongicides pour les champignons ou des
herbicides pour les végétaux, associés à un nettoyage mécanique. Mais, là
encore, les analyses devraient permettre de prendre en compte le degré de
dégradation de la pierre afin de quantifier l’intervention.
Le dessalage de la pierre peut également être envisagé
comme une forme de nettoyage, or il s’agit là d’une opération qui peut s’avérer
plus fastidieuse et coûteuse qu’efficace, surtout sur un monument aussi vaste
que l’amphithéâtre. De plus, les sels cristallisés peuvent parfois, dans un
stade avancé d’altération, être la seule substance fixant la pierre pulvérulente,
ce qui nécessite une consolidation pour éviter la désagrégation du matériau.
Ainsi, la consolidation, qui définit tout «traitement
destiné à améliorer les caractéristiques de cohésion et d’adhésion entre les
constituants d’un matériau minéral »,
peut être envisagée avant le nettoyage. En traitement sur place, la difficulté
réside dans l’obtention d’une bonne profondeur de pénétration du produit,
qui ne doit pas stagner en surface pour éviter de fixer les dépôts ou empêcher
la pierre de respirer.
Ce sont donc des traitements qui doivent être choisis
après concertation entre les différents acteurs du projet de restauration
suivant le niveau des intérêts de chacun. Le coût et la durée du traitement
sont des variables tandis que le souci d’efficacité et de neutralité est supposé
commun à tous. Mais compte tenu de l'importance de la surface à traiter, des
interventions ponctuelles et ciblées seraient peut-être préférables à une
action globale, trop longue et qui risquerait de ne pas aboutir.
La substitution est, quant à elle, envisageable pour
des éléments très détériorés et à la fonction architectonique importante,
comme les clefs de voûtes. (fig.
62). Mais ces nouveaux éléments devront « s’intégrer harmonieusement
à l’ensemble ».
Le remplacement des goujons en fer, soutenant les dalles du podium, par
des éléments inoxydables apparaît indispensable dans la mesure où cela détériore
la pierre elle-même. De même pour les mortiers, qui sont, soit dégradants,
soit inexistants.
En ce qui concerne les dalles du promenoir supérieur,
le problème de substitution est sous-tendu par une question déontologique
d’une autre ampleur.
La prévention reste cependant la meilleure solution.
2. La prévention : la conservation
La prévention est le meilleur moyen d’éviter les problèmes
et les campagnes de restauration longues et coûteuses. Le but est de maintenir
le monument en bon état afin de prévenir la détérioration.
Parmi les moyens préventifs, l’application de produits
de protection peut être envisagée comme un complément au nettoyage, en ce
qu’ils protègent la pierre des effets néfastes de l’infiltration d’eau. L’efficacité
de ces produits hydrofuges réside dans leur bonne pénétration dans le réseau
capillaire en le rendant quasiment imperméable. Comme pour les consolidants,
auxquels ils sont souvent associés, la pierre doit pouvoir continuer à respirer
en maintenant des échanges avec l’extérieur. Ces produits, qui doivent également
être stables chimiquement et réversibles, sont souvent d’application peu aisée
et exigent un personnel hautement qualifié or, pour être efficaces, leur application
doit être globale sinon cela ne fait que reporter le problème sur les pierres
voisines sans le résoudre. Par conséquent, le choix de leur utilisation reste
délicat. Un autre inconvénient, et non des moindres puisqu’il suppose l’inefficacité
de cette méthode, est que l’application de produits hydrofuges n’est envisageable
que si les circulations d’eau dans le matériau sont réduites au maximum, or,
les remontées capillaires restent encore un problème à régler.
Ainsi, plus qu’un complément au nettoyage, ces agents
de protection peuvent être considérés comme un complément à un autre système
préventif qui agit directement sur les causes d’altération et dont le but
premier est également de réduire la pénétration de l’eau à l’intérieur de
la structure poreuse de la pierre. Le choix des méthodes dépend des résultats
des analyses faites sur le terrain révélant les chemins d’eau au niveau des
sous-sols et dans la structure. L’une des solutions à envisager serait la
mise en place d’un système d’évacuation des eaux général permettant d’assainir
les sous-sols. Concernant les remontées capillaires, la mise en place d’un
système d’isolation des fondations pourrait s’avérer efficace pour protéger
les structures.
Assurer l’étanchéité des zones devenues totalement perméables,
est également indispensable. Ainsi, toutes les voûtes mises à nu par la disparition
de la structure protectrice des gradins exigent un système de protection radical,
les rendant étanches, car si cette opération n’est pas effectuée au préalable,
la restauration est inefficace comme on le voit actuellement pour les voûtes
restaurées en 1987 qui subissent des infiltrations. (fig.
63)
Un autre facteur de dégradation du matériau réside dans
les conditions de son utilisation. La solution paraît simple ici en théorie
puisqu’il suffirait de ménager la structure par des aménagements appropriés
réduisant l’impact des différentes vibrations dues à l’usage et évitant ainsi
l’aggravation des fissures inhérentes. En pratique, savoir ce qui est le plus
approprié est une question de spécialiste car cela fait intervenir des paramètres
très divers, comme le choix du matériau pour les gradins, aux propriétés les
plus adéquates pour supporter les tensions, les intempéries et répondre à
des impératifs de sécurité.
Une fois que les mesures de protection ont été prises,
le meilleur moyen de conservation reste encore l’entretien régulier de l’édifice,
comme le précise l’article 4 de la Charte
de Venise : « La conservation des monuments impose d’abord la
permanence de leur entretien». (p. XXI) Au regard des archives du Service
Départemental de l’Architecture et du Patrimoine, il ne semble pas que l’amphithéâtre
d’Arles ait jamais fait l’objet de soins particuliers et le nettoyage se limite
actuellement à la remise en l’état des gradins avant la saison des spectacles.
Toutes ces solutions sont, certes, à choisir en fonction
de la particularité du monument, mais, dans l’optique d’une politique d’intervention
encore plus proche de sa situation, et dans le but d’établir une continuité
dans son histoire d’édifice de spectacles, certaines solutions peuvent être
cherchées dans le passé de l’amphithéâtre.
II.
L’aspect déontologique des
interventions
Dans le cadre de la restauration, la Charte
de Venise, dans son article 9, précise qu’ « elle a pour but de conserver
et révéler les valeurs esthétiques et historiques du monument et se fonde
sur le respect de la substance ancienne et de documents authentiques ».
De même, «les apports valables de toutes les époques à l’édification d’un
monument doivent être respectés, l’unité de style n’étant pas un but à atteindre
au cours d’une restauration » - article 11.
Ainsi, il s’avère primordial de respecter l’histoire
du monument, dans un souci d’intégrité ; histoire de l’origine tout d’abord,
de sa création antique, et histoire depuis son dégagement au XIX° siècle.
Les solutions les plus récentes restent cependant sujettes à caution.
A.
La reprise des solutions antiques
Le but n’est donc pas une reconstitution intégrale du
monument tel qu’il devait être dans l’Antiquité, même si la reconstitution,
sous forme de maquette ou en images de synthèse, reste un travail indispensable
pour appréhender l’édifice dans son état originel et mieux le comprendre.
(fig. 64 et 65).
Cela permet également d’envisager, sans erreurs historiques, quelques restitutions
ponctuelles qui peuvent être souhaitables si elles sont utiles pour aborder
le monument et si elles sont visiblement modernes, tout en étant intégrées
à celui-ci.
L’esprit dans lequel il a été conçu se perpétue à l’heure
actuelle par son utilisation comme lieu de spectacle, fonction primordiale
de l’amphithéâtre, et c’est dans cette continuité d’esprit que des solutions
sont peut-être à chercher, au-delà de l’aspect purement formel de la restauration.
1. La circulation des personnes et des eaux
L’essence même d’un amphithéâtre réside dans l’efficacité
de son système de circulation, système permettant une fluidité des déplacements
et assurant une sécurité maximum au public. L’état lacunaire de l’édifice
ne permet pas de restituer les espaces détruits, néanmoins, il est possible
de faire coïncider ce qui reste avec les aménagements modernes afin d’assurer
une efficacité maximum, notamment en cas d’évacuation rapide.
Cela suppose la multiplication des accès aux gradins,
à l’image des 28 vomitoires antiques encore en place, desservant le podium et
la partie inférieure du deuxième maenianum
(V1 et V2),
pratiquement tous utilisés, et des 56 autres aujourd’hui disparus ou non usités,
comme l’amorce des vomitoires V3
encore visible dans la partie sud de la galerie d’entresol.
Cette rapidité d’évacuation doit être relayée par une
fluidité de circulation dans les galeries et travées, ce qui suppose qu’elles
soient suffisamment dégagées et éclairées. Pour éviter des stationnements
trop longs et dangereux, la multiplication des sorties de secours peut s’avérer
nécessaire. A l’époque romaine, le monument était probablement accessible
par les 60 arcades, ce qui permettait aux spectateurs de sortir rapidement.
Or, les spectacles de l’amphithéâtre n’étant plus un privilège de citoyen
romain, la fermeture des arcades afin de canaliser le flux du public est devenu
une nécessité. Toutefois, le système actuel peut probablement être amélioré
et adapté pour les cas d’urgence.
L’aspect pratique de l’esprit antique se retrouve également
dans l’organisation du système d’évacuation des eaux. Là encore, les aménagements
originaux semblent peu avantageux à réutiliser vu ce qu’il reste de la structure.
En effet, des conduits d’environ 30 cm de diamètre, creusés à l’intérieur
des murs rayonnants, recueillaient l’eau de pluie provenant des escaliers
menant à l’attique et au dernier maenianum
et la déversaient sur le sol des travées du rez-de-chaussée. (fig.
66 et 67). Ces conduits
ont été bouchés par du ciment à l’époque moderne et leur utilisation, tels
quels, n’apparaît d’aucune utilité puisque cette partie de la cavea
a entièrement disparu. Par contre, en fonction des aménagements choisis pour
la restauration, ils peuvent peut-être servir à nouveau pour la collecte
des eaux de pluie ou, du moins, inspirer la création d’un système d’évacuation
vertical similaire qui est, de toutes façons, indispensable pour éviter les
infiltrations. Le principe du déversement de l’eau directement sur le sol
du rez-de-chaussée peut cependant être modifié dans un souci de confort du
public et de salubrité. Le raccordement à un système d’égouts général, déjà
évoqué précédemment, semble envisageable.
Un second système d’évacuation existe au niveau de la
première précinction du podium,
où une rigole est encore visible. Elle semblerait correspondre avec les «gargouilles »
qui déversaient les eaux au niveau des sous-sols.
Ce réseau est également cimenté à l’heure actuelle mais sa réutilisation peut
apparaître tout à fait plausible, après étude du cheminement des eaux et raccordement
à un système général de drainage évitant une inondation des souterrains.
Ces aspects pratiques de la réutilisation de principes
antiques peut se doubler d’un aspect beaucoup plus didactique au travers des
restitutions.
2. Les éventuelles restitutions
La restauration d’un état originel dont l’existence
est confirmée par la présence de traces éloquentes ou d’éléments encore en
place peut être envisagée dans la mesure où ces restitutions sont souhaitables
pour la compréhension du monument, et réalisables.
L’une des propositions de l’architecte en chef des monuments
historiques, monsieur Perrot, dans son étude préalable, consiste à rehausser
l’arène à son niveau antique, soit plus de deux mètres au-dessus de son état
actuel, ce qui permettrait de restaurer la forme élégante de l’ellipse originelle,
soulignée par le mur du podium.
Mais cela impliquerait également le dégagement des gradins installés en contrebas,
et donc une nécessaire compensation des places ainsi perdues.
Si cette intervention a un aspect esthétique et didactique
avéré, en ce qu’elle donne à voir le savoir-faire des architectes antiques,
elle pourrait également offrir des avantages pratiques.
Ainsi, la bonne visibilité, qui est un des soucis ayant
présidé à la création du monument amphithéâtre, et qui est toujours une question
d’actualité par rapport aux spectacles, serait en partie restaurée
par le rehaussement de la piste et le rétablissement de sa courbe d’origine.
Cela suppose cependant une adéquation du système moderne de gradins et d’éclairage.
Le second aspect pratique concerne l’espace libéré sous
l’arène. Celui-ci devait permettre d’abriter le système technique de machineries
et des éléments de décor, or, aucun sondage de cette partie n’a été fait depuis
le dégagement du monument puisqu’il fut immédiatement utilisé. L’enjeu de
la restitution se situe ici, car si le système de poutraisons soutenant le
plancher de l’arène est visible par les traces au niveau du soubassement du
mur de podium, les supports verticaux
de ce plancher restent inconnus : les fondations étaient-elles en bois
ou en pierre comme au Colisée ? Et surtout, en reste-t-il des traces ?
Des réponses apportées par les fouilles archéologiques dépendent la possibilité
ou non de restituer ce plancher et, du même coup, remet en cause l’éventuelle
réutilisation pour des locaux techniques, car, comme le précise l’article
9 de la Charte de Venise,
la restauration « s’arrête là où commence l’hypothèse […] ».
La restitution du promenoir supérieur est une restauration
également proposée par monsieur Perrot dans son projet. Là encore la décision
est délicate.
La vision en élévation de la galerie extérieure depuis
le rez-de-chaussée est actuellement
faussée par l’absence quasi-totale du couvrement en dalles monolithes, formant
séparation avec le premier étage. Ainsi, le public a une impression d’élan
vertical vertigineux, totalement différente du parti initial. Or, il s’avère
que ce choix architectural, motivé par un souci de régularité de la façade
(les voûtes, comme à Nîmes, auraient rehaussé le niveau du premier étage),
a dû montrer ses faiblesses peu de temps après sa réalisation. La réutilisation
de ces dalles a dû finir de dépouiller la galerie extérieure du rez-de-chaussée
de son couvrement.
Dans un aspect didactique, afin de rétablir la vision
antique, il apparaît intéressant d’évoquer le dallage original en respectant
les principes posés par l’article 12 de la Charte
de Venise selon lequel «les éléments destinés à remplacer les parties
manquantes doivent s’intégrer harmonieusement à l’ensemble, tout en se distinguant
des parties originales, afin que la restauration ne falsifie pas le document
d’art et d’histoire ». Quant aux éléments extrêmement dégradés, leur
dépose s’avère indispensable pour la sécurité du public car une chute est
toujours possible.
Ensuite, dans quelle mesure cette restitution doit-elle
se faire ? Tout le problème est là, car le monument est grand et son recouvrement
général risque d’être onéreux. Peut-être qu’un réaménagement de la partie
déjà restaurée en 1946 serait approprié, en l’intégrant dans une continuité
historique.
B.
La question des interventions
depuis le dégagement
Par ce dernier exemple, il est intéressant de constater
que le souci de se rapprocher du modèle antique était déjà présent avant et
présidait aux interventions précédentes. Cependant, la ligne de conduite actuelle
semble plutôt tendre vers une harmonisation de ces politiques d’intervention.
1. Un esprit de continuité
Dès le dégagement, une remise en l’état s’est avérée
nécessaire du fait des dégradations engendrées par l’occupation du monument.
Mais si sa réutilisation immédiate a permis de lui redonner vie, d’un autre
coté, cette nécessaire utilité a parfois freiné la réalisation de travaux
d’importance.
Ce retour à sa vocation de lieu de spectacle a orienté
l’exécution des restaurations sur le modèle antique, par souci d’harmonie
esthétique et quelquefois technique.
Ainsi, lorsque l’architecte H. Revoil propose en 1861
la reconstruction de quatre rangées de gradins, il signifie explicitement
que cette restauration doit se baser sur des parties identiques existantes,
donc, conformément à la construction romaine, dans la forme, la position ou
la nature des matériaux. Le devis, approuvé le 8 mai 1862, prévoira cependant
des petits moellons, en «pierre de Castellete », plutôt que des pierres
de taille, probablement pour des raisons financières.
Ce souci de continuité esthétique s’est surtout cristallisé
autour de la question de l’arène depuis le début du XIX° siècle, qui met également
en exergue les différences d’intérêts qui peuvent survenir à propos de l’usage
de l’amphithéâtre. Ainsi, en 1903, le bail de l’adjudicataire des spectacles
arrivant à terme, est évoquée la destruction d’une tribune construite à l’intérieur
de l’arène avant une nouvelle attribution du lieu. Les protestations qui ont
suivi cette décision ont permis, pour la première fois, de définir les problèmes
causés par ce genre d’occupation. Ils sont au nombre de trois pour Jules Formigé:
dégradation des dalles du podium soumises aux passages des spectateurs
et à leurs frottements – rupture de la belle forme de l’ellipse – matériaux
utilisés, bois et fer, tranchant avec le caractère grandiose du monument.
Ces trois points apparaissent encore en filigrane aujourd’hui, au moment où
l’occupation de l’arène est toujours effective.
A partir de 1948, c’est le rehaussement de la piste
qui est évoqué et les débats tournent autour de la hauteur de ce rehaussement.
A cela, Fernand Benoit, directeur de la XII° circonscription archéologique
des antiquités, répond que «la seule façon de remédier à la profondeur anormale
de la piste est de reconstituer le plancher à la hauteur où il était à l’époque
antique ». Or, après une tournée d’inspection générale en 1960, le projet
sera abandonné.
Ce souci du respect de l’Antiquité est donc toujours
présent aujourd’hui et fut à nouveau à l’ordre du jour lors de la campagne
de restauration de 1987, dirigée par monsieur Dufoix. Son projet de rétablir
le sol de l’arène à son niveau antique comprenait également l’attribution
du sous-sol ainsi dégagé à la recherche archéologique, puis à des aménagements
techniques.
Néanmoins, s’il y a bien un esprit de continuité, en
ce que chaque intervention suppose une référence au modèle antique, il n’y
a pas de réelle continuité de l’esprit puisque ces mêmes interventions relèvent
d’interprétations personnelles, souvent purement formelles.
Ainsi, l’éventuelle réutilisation du système antique
d’évacuation des eaux n’a jamais été évoquée alors que le problème des infiltrations
s’est posé dès le début. En 1845, dans son projet de restauration, Charles
Questel suggérait de combler les voûtes avec du bitume recouvert de gazon,
solution désapprouvée par les inspecteurs généraux, messieurs Mérimée et Caristie,
car risquant d’aggraver la situation plus que d’y mettre un terme. En 1864,
Henri Revoil propose d’en assurer l’étanchéité par une couche de béton.
Jusqu’au début des années 1920, les multiples interventions
de consolidation ou de restauration ne semblent plus concerner prioritairement
la protection des voûtes, à part la mention d’autres chapes de béton en 1876.
En fait, ce sont des travaux de conservation qui vont être entrepris par les
rejointoiements successifs des voûtes, jusqu’en 1987. Travail qui est encore
à envisager aujourd’hui puisque les joints sont quasi-inexistants au niveau
des voûtes de l’entresol, à cause des lessivages à répétition.
2. Un souci d’harmonisation
A travers la politique actuelle de rationalisation de
l’intervention, se fait jour la nécessité qui aurait dû être présente dès
le début : le souci de vérité historique par la recherche documentaire
et les fouilles, ce qui aurait peut-être permis une plus grande coordination
dans les différents projets successifs et une homogénéité dans les interventions.
Ainsi, toutes les questions que nous venons de voir
sont encore d’actualité, 185 ans après le dégagement et n’ont toujours pas
été résolues.
La mise à jour des plans et la vérification des différents
relevés précédents semblent être une nécessité afin d’aborder le monument.
En effet, si les informations de base sont erronées, les interventions consécutives
risquent d’être également faussées. Ainsi, les relevés que fit Charles Questel
au moment du dégagement sont à étudier de près car, notamment au niveau de
l’infrastructure, il a mentionné des espaces qui n’ont toujours pas été sondés
et qui ne sont pas visibles actuellement.
Ces mesures sur le terrain permettraient d’établir des plans tenant compte
des particularités du monument, dans ses dimensions par exemple. Les plans
actuels sont normalisés en ce qu’ils offrent une régularité du rythme tenant
plus de la typologie que de la réalité.
(fig. 68). Une étude complète
suppose également la pratique de sondages archéologiques afin d’analyser le
système de fondation antique, les techniques de construction et de découvrir
les différents stades d’occupation avant l’érection du monument. En 1946 et
1950, des fouilles du coté nord-est ont mis au jour une partie de l’enceinte
augustéenne et les vestiges d’une tour, déjà mentionnés par Charles Questel,
et qui témoignent d’une modification de l’urbanisme pour permettre la réalisation
de cet édifice monumental. La découverte, à la même époque, de céramiques
de la période flavienne (70-90 ap. J.-C.) est venue confirmer la datation
du monument, qu’une étude stylistique apparente au Colisée de Rome, inauguré
en 80 ap. J.-C. par Titus.
A part une autre campagne de fouilles en 1976-1980,
apportant témoignage d’une occupation tardive du monument, depuis une cinquantaine
d’années, les sous-sols n’avaient plus été sondés. A la demande de monsieur
Perrot, deux sondages ont été réalisés en 1998-1999, sous la direction de
messieurs Heijmans, Bremond et Pitou de l’Institut de recherche sur la Provence
antique, dans le cadre du projet de restauration actuel. Celui réalisé sur
la travée 8 (nord-est) semble réfuter la théorie selon laquelle le terrain
aurait été arasé systématiquement avant la construction. En effet, la stratigraphie
démontre une occupation antérieure et une utilisation du sol de l’époque comme
support de construction.
Ces différentes prospections amènent à une étude exhaustive
venant compléter les autres analyses scientifiques, offrant ainsi une base
de travail solide.
La prise en compte de la particularité du monument,
condition sine qua non d’une politique d’intervention adéquate, révèle,
d’une manière plus large, l’aspect particulier de ce type de monument.
III.
Des particularités à considérer
Les développements précédents
ont essayé de montrer à quel point ces monuments historiques, par leur utilisation,
sont effectivement à part, et que, par conséquent, les problèmes qui se posent
exigent des réponses adaptées. Ces particularités ont été récemment reconnues
par l’Europe de la coopération culturelle qui, lors du Colloque
international de Vérone en août 1997, a élaboré une charte européenne
sur l’utilisation des lieux antiques de spectacle.
Ce texte met justement l’accent sur les questions de
collaboration des différents intervenants dans le sens d’une valorisation
de ces édifices de spectacle par leur utilisation et la prise en compte de
tous les publics. Ainsi, pour trouver cet équilibre, les aspects fonctionnels,
esthétiques et didactiques sont à considérer.
A.
« Valoriser le site en
l’utilisant »
Il s’agit, en quelque sorte, de joindre l’utile à l’agréable.
Comme le précisait déjà l’article 5 de la Charte
de Venise de 1964 : « La conservation des monuments est toujours
favorisée par l’affectation de ceux-ci à une fonction utile à la société […] ».
(p. XXII). Mais la notion essentielle qui sous-tend ce principe est le respect
de l’édifice.
1. Le respect du lieu
Le respect des règles de sauvegarde et de protection
lors des représentations devrait être envisagé afin d’assurer la sécurité
du monument. Cela suppose une définition des règles de bon usage de l’amphithéâtre,
par concertation entre la municipalité, propriétaire, les responsables de
la conservation et les organisateurs de spectacles afin de réduire au maximum
les risques de dégradation matérielle des structures antiques.
Ainsi, le dégagement du matériel technique encombrant
les galeries du sous-sol et les niveaux supérieurs, et leur regroupement en
des lieux adaptés, permettraient d’éviter des dégradations dues à la manipulation
et au stockage de ces éléments, tout en rendant le monument plus attractif
car plus dégagé.
En revanche, la mise en place d’un système de gradins
provisoires n’est pas forcément une solution utile car cela suppose des moyens
logistiques importants alors que le plus haut taux de fréquentation touristique
correspond avec la saison des spectacles. De plus, l’adaptation de ce système
pourrait même offrir une protection supplémentaire au monument au lieu d’être
un facteur de dégradation, par exemple, en jouant un rôle dans le système
d’évacuation des eaux. Par conséquent, à défaut d’équipements temporaires,
leur entretien régulier, été comme hiver, serait souhaitable pour éviter les
altérations et offrir une image agréable de l’édifice au visiteur, quelle
que soit la saison. La création d’une équipe d’entretien permanente, attachée
à la municipalité, pourrait assurer le nettoyage courant et, peut-être travailler
en collaboration avec le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine
pour des interventions un peu plus lourdes, comme le désherbage.
2. Le respect de la fonction
Respecter la fonction de spectacle et la vocation touristique
du lieu, passe par la mise en place d’équipements adaptés et neutres.
Ainsi, puisque la structure des gradins fait partie
intégrante de l’amphithéâtre, il serait intéressant qu’elle permette à la
fois une bonne visibilité des spectacles ainsi qu’une lisibilité du monument
satisfaisante pour le visiteur, et cela, en créant une harmonie esthétique
par une continuité visuelle.
De même, la mise en place d’un système d’éclairage performant
et adapté, renforcerait la qualité du spectacle à travers la valorisation
du site.
Enfin, il est important de prendre en compte les besoins
logistiques du personnel et ses conditions de travail car des aménagements
adéquats peuvent améliorer ceux-ci tout en respectant le patrimoine, que ce
soit pour les personnes de la billetterie ou celles participant à l’organisation
des spectacles.
B.
Prendre en compte tous les
publics
Visiteurs et spectateurs ont droit au même traitement
et cela suppose l’amélioration de l’accueil ainsi que le développement de
l’information du public.
1. Assurer la qualité de l’accueil
Cet accueil passe d’abord par un système de billetterie
plus satisfaisant et attractif, capable de faire face à la fréquentation importante
du site en haute saison et d’offrir au visiteur un premier contact agréable
avec le monument, tout au long de l’année.
Il faut également souligner le problème d’accessibilité
du monument, permettant une fluidité de circulation et améliorant la sécurité
en cas de danger nécessitant une évacuation rapide. Cette accessibilité doit
évidemment prendre en compte le public handicapé, ignoré à l’heure actuelle,
qu’il s’agisse de personnes à mobilité réduite ou à déficience visuelle, par
la mise en place de rampes d’accès adaptées et de signaux tactiles jalonnant
les espaces de circulation.
Cela renvoie donc au respect de normes de sécurité à
définir pour l’amphithéâtre, en considérant sa configuration et les lacunes
dans ce domaine. Ainsi, il peut s’agir d’améliorer l’éclairage des galeries
et le balisage des zones dangereuses pour le public et pour le monument, car
trop fragiles, ou de faciliter l’accès et le travail des équipes de secours
par un matériel suffisant et en bon état sur place. Mais cela peut également
passer par la prise en compte de la capacité d’accueil du public pour éviter
une surfréquentation néfaste et la mise en place d’un dispositif d’encadrement
du public afin de prévenir tout risque supplémentaire dommageable pour les
personnes, par des situations physiquement dangereuses, ou pour le monument,
par des dégradations.
2. Développer l’information du public
Cette étape est très importante car améliorer la connaissance
de l’édifice est déjà un premier pas vers le respect, par la prise de conscience.
Il serait donc utile de mettre en place une campagne de sensibilisation auprès
de la population locale, et notamment du jeune public, pour qui l’amphithéâtre, ou les arènes, fait partie
intégrante de la vie quotidienne.
Dans une optique purement touristique, le manque d’information
sur le terrain peut gêner le visiteur. Ainsi, le succès des visites conférences
mensuelles, organisées par l’Office de Tourisme, à partir de février, témoigne
de l’importance de la demande du public face à une offre trop rare. En effet,
en haute saison, les visites guidées se limitent à une heure par jour, quel
que soit le nombre de visiteurs, ce qui peut être vite insupportable quand
les groupes sont trop nombreux ou frustrant lorsque l’horaire est passé. Une
collaboration avec l’Office de Tourisme pour préparer un programme de visite
plus étoffé et plus flexible serait peut-être une solution. La mise en
place de circuits permettant de découvrir librement le site au travers de
son histoire serait opportun. Ainsi, aborder son utilisation antique et
sa réoccupation médiévale par des cheminements appropriés supposerait, notamment,
l’aménagement des sous-sols à la visite, ou une mise en valeur plus importante
des tours, trait quand même caractéristique de l’amphithéâtre d’Arles. La
présence de panneaux explicatifs qui jalonneraient le parcours peut être envisagée
à la condition qu’ils n’«encombrent» pas les passages lorsque le monument
est utilisé. Ils peuvent également être mobiles, évitant ainsi une trop rapide
dégradation.
La création d’un espace « librairie », regroupant
des instruments informatifs complémentaires et spécialisés, tels que livres,
maquettes ou CD-roms, permettrait de resituer le monument dans un ensemble
et d’offrir un support culturel attractif. La localisation de cet espace est,
en revanche, plus problématique et les différentes opinions à ce sujet se
défendent. Ainsi, d’un coté, l’installer à l’intérieur de l’amphithéâtre offrirait
une proximité permettant une confrontation immédiate avec le lieu, et donc
une compréhension plus aisée. Mais cela ne va-t-il pas engendrer un encombrement
supplémentaire inadéquat ? D’un autre coté, situer cet espace à l’extérieur,
entre le théâtre et l’amphithéâtre par exemple, serait une sorte d’étape informative
dans le parcours antique de la ville. Toutefois, le risque est de créer un
phénomène de « double-emploi » avec le Musée de l’Arles antique
qui est déjà un support culturel à l’appréhension de la ville par ses monuments.
Le choix est donc délicat.
Enfin, l’adjonction d’une boutique de souvenirs ou d’un
café n’est pas une nécessité en ce que ces deux structures abondent déjà autour
du monument et que les cafés offrent un point de vue sur l’extérieur de l’amphithéâtre
tout à fait agréable. Penser à un système de buvette plus adapté lors des
spectacles semblent être plus en rapport avec une réalité d’utilisation.
La question de l’avenir de ces édifices est donc d’actualité.
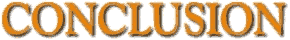
Aborder les problèmes de conservation et de restauration
de l’amphithéâtre d’Arles a donc permis de montrer les limites à l’utilisation
de ce type d’édifice, limites à ne pas franchir afin de sauvegarder le monument
même. Eviter les situations extrêmes et les comportements à risques sont les
principales solutions à envisager pour que ces monuments historiques soient
toujours utilisés tout en étant protégés.
Le maître-mot à retenir est peut-être celui de respect :
respect du monument, respect du public et respect des intérêts de chacun.
Or, les désaccords récurrents entre les différents intervenants, apparus dès
la réutilisation de l’amphithéâtre, ont, en fait, le plus souvent mené à des
actions stériles, car rarement acceptées à l’unanimité.
La quatrième partie de l’annexe I de la Charte
de Vérone de 1997 propose « l’établissement de codes négociés de
bonne pratique adaptés à chaque site ». Mais, au-delà de ce cahier des
charges définissant les conditions d’utilisation de l’amphithéâtre, la création
de règles générales et supérieures peut s’avérer utile pour faciliter la gestion
du fonctionnement du monument, qui résulte actuellement d’un état de fait
imposé par la nécessité d’organiser des spectacles, et cela depuis 1830. Or,
il apparaît, au travers de la Charte
de Vérone, que cette situation ne soit pas spécifique à l’amphithéâtre
d’Arles et qu’une législation particulière pour les édifices antiques de spectacle
soit peut-être envisageable.
Considérer le caractère
exceptionnel d’amphithéâtres comme celui de Arles ou de Nîmes, les seuls à
être aussi bien conservés en élévation en France, c’est également faire un
pas vers une autre approche de ces édifices. Ainsi, resituer l’amphithéâtre
d’Arles dans un contexte plus large de prise en compte du patrimoine romain
à travers l’Europe peut permettre de partager les connaissances et les expériences
de chaque pays dont les problèmes sont suffisamment proches pour que les solutions
soient riches en enseignement. Mais cela ne doit pas occulter le fait que,
Arles et son amphithéâtre s’inscrivent dans un patrimoine propre à la Provence
antique. C’est donc, avant tout, un témoin de la civilisation romaine en Narbonnaise,
au même titre que celui de Nîmes, ou que d’autres monuments et sites gallo-romains
. La mise en place d’un programme inter-régional de restauration, conservation
et valorisation de ce patrimoine permettrait un travail de proximité et donc
des actions plus ciblées, auxquelles l’Institut de recherche sur la Provence
antique d’Arles offrirait une coordination scientifique et technique.
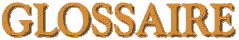
Carcer (plur. carceres) : pièce où les animaux
étaient enfermés peu de temps avant d’être lâchés dans l’arène.
Cavea : partie annulaire et concave de l’amphithéâtre
constituée par l’ensemble des gradins et leur structure de support.
Forum : place publique romaine qui était le centre administratif,
religieux et commercial de la ville.
Maenianum (plur. maeniana) : portion annulaire
de la cavea de l’amphithéâtre rassemblant une série de gradins.
Podium : partie inférieure de la cavea ne comprenant
que quelques gradins où prenait place les personnes de marque.
Pompa : défilé des dignitaires dans la ville et dans
l’arène avant le début des jeux.
Précinction
(Praecinctio -plur. praecinctiones): étroite zone de rupture dans
la pente générale des gradins correspondant à un espace de circulation séparant
deux maeniana successifs.
Sacellum : chapelle qui pouvait être dédiée à Mars, Hercule,
Diane ou Némésis.
Velum (plur. vela) : ensemble des voiles de lin
que l’on tendait au-dessus du public pour le protéger du soleil.
Ce
glossaire est librement inspiré de celui proposé par Golvin (J.C.) et Landes
(C.) dans Amphithéâtres et gladiateurs, 1990, p. 232-233.

1. Les sources
¨ Sources manuscrites
§
Archives de la Bibliothèque du Patrimoine,
Amphithéâtre d’Arles : 1823-1993,
Paris.
§ Archives de la Conservation régionale des Monuments
Historiques de la Région PACA, Aix-en-Provence.
§ Archives du Service Départemental de l’Architecture
et du Patrimoine, Amphithéâtre d’Arles :
1984-1997, Arles.
§
Archives municipales, Amphithéâtre d’Arles : 1825-1982,
Arles.
¨ Sources imprimées
§ FINCKER Myriam, Analyse
comparée des amphithéâtres d’Arles et de Nîmes, Doctorat d’Université
sous la direction de Pierre Gros, professeur à l’Université de Provence, Aix-en-Provence,
1989.
§ HEIJMANS Marc, BREMOND Jacques et PITOU Jean, Rapport des fouilles de 1998-1999, Institut
de Recherche sur la Provence Antique, Musée de l’Arles antique, Laboratoire
d’archéologie, Arles.
§
PERROT Alain-Charles, Amphithéâtre : conservation, mise en valeur
et utilisation du monument ; Etude préalable, Département des Bouches-du-Rhône,
Arles, juin 1998.
¨ Sources orales
Il
apparaît plus pertinent d’évoquer les sources orales par ordre chronologique
des entretiens, plus représentatif de l’évolution de mon travail, que par
ordre alphabétique.
§ SINTES Claude, Conservateur en chef des musées d’Arles.
§
SABEG Bouzid, Directeur du service
du Patrimoine de la ville d’Arles.
§ QUENEE Bernard, Ingénieur au Laboratoire d’Etudes et
de Recherches sur les Matériaux, Arles.
§
FINCKER Myriam, Architecte à l’Institut
de Recherche de l’Architecture Antique de Pau.
§ HEIJMANS Marc, Archéologue à l’Institut de Recherche
sur la Provence Antique, Musée de l’Arles antique.
§ SIMON Jean-Christophe, Conservateur régional des Monuments
Historiques, Aix-en-Provence.
2. Les ouvrages
¨ Généralités sur le monde romain
Ø
La civilisation
§ GROS Pierre, La
France gallo-romaine, Paris, Nathan, 1991.
Ø
L’architecture
§ ADAM Jean-Pierre,
La construction romaine : matériaux et techniques, Paris, Picard,
1984.
Ø
Les amphithéâtres
§
Dossiers
Histoire et Archéologie, Les amphithéâtres de la Gaule, Quétigny, Fatou, n° 116 mai 1987.
§ GOLVIN Jean-Claude, L’amphithéâtre romain : essai sur la théorisation de sa forme et
de ses fonctions, Paris, De Boccard, 1988.
§
GOLVIN Jean-Claude et LANDES Christian,
Amphithéâtres et gladiateurs, Paris, Presses
du CNRS, 1990.
§
GRENIER Albert, Manuel d’archéologie gallo-romaine : troisième partie, l’architecture
– Ludi et circences - théâtres, amphithéâtres
et cirques, Paris, Picard, 1958.
¨ La pierre
§ BEDON Robert, Les
carrières et les carriers de la Gaule romaine, Paris, Picard, 1984.
§
DOMASLOWSKI Wieslaw, La conservation préventive de la pierre, coll. Musées et monuments
– XVIII, Paris, UNESCO, 1982.
§ LAZZARINI Lorenzo et TABASSO Marisa Laurenzi, La restauration de la pierre, Maurecourt,
ERG, 1989.
§
PHILIPPON Jacques, JEANNETTE Daniel
et LEFEVRE Roger-Alexandre (coordonné par) ,
La conservation de la pierre monumentale en France, Paris, Presses du
CNRS, 1992.
![]()